Articles récents
Horkheimer et les réformateurs religieux
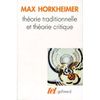 Tous les lettrés connaissent vaguement l'existence de l'Ecole de Francfort, ne serait-ce que parce qu'on leur apprend qu'Habermas en est issu.
Tous les lettrés connaissent vaguement l'existence de l'Ecole de Francfort, ne serait-ce que parce qu'on leur apprend qu'Habermas en est issu.
Je relisais récemment un bouquin d'un de ses membres les plus éminents, Max Horkheimer, Théorie Traditionnelle et Théorie Critique (ed Tel Gallimard, j'ignore s'il est encore édité). Je m'y suis plongé par désoeuvrement comme je l'avais fait avec Le génie du Christianisme de Châteaubriand il y a quelques mois.
Bizarrement j'ai découvert à cette occasion qu'un de ses essais, qui forme un chapitre du livre, "Egoïsme et émancipation", daté de 1936, se penche sérieusement sur un sujet qui me tient à coeur : le lien entre réforme politique et réforme morale. Il s'intéresse particulièrement à Rienzo, Savonarole, Luther, Calvin, et d'une façon très suggestive étend sa liste jusqu'à Robespierre.
Il y a dans sa démonstration de fâcheuses simplifications inhérentes au dogmatisme marxiste qui l'incitent à voir dans ces prédicateurs de simples "chiens de garde" de la bourgeoisie dont l'unique fonction est de "formater" le peuple en fonction des intérêts de cette classe, en retournant ses aspirations légitimes vers une forme de flicage de soi-même et d'autoculpabilisation permanente. Tout cela n'est pas satisfaisant intellectuellement car cela ne permet pas de comprendre par exemple l'engouement de la noblesse française pour le protestantisme (une noblesse aux intérêts souvent opposés à ceux de la bourgeoisie). Mais Horkheimer a raison quand même de souligner ( et c'est le b-a ba de la sociologie) qu'une quête spirituelle ne nait pas "hors sol", que Luther a beau être un fils de paysan, il s'adresse tout de même à une certain public urbain, et, à ce titre, est tributaire des mouvements sociologiques de son temps, c'est-à-dire de la montée de la bourgeoisie dans les villes.
Il y a des remarques très importantes dans le travail d'Horkheimer, sur la convergence de la théorie protestante avec l'individualisme bourgeois sur la question de la rupture avec un clergé romain médiateur de la relation aux Ecritures, ou sur la valorisation de la "vocation" dans l'activité professionnelle. J'aime beaucoup l'inspiration nietzschéenne du philosophe qui reproche au penseur moustachu un certain an-historisme, mais lui rend aussi hommage sur certains points. Elle lui permet de livrer une critique radicale du protestantisme dont il dénonce tout à la fois l'anti-intellectualisme (je n'y avais jamais songé), et la haine profonde des masses (autrement dit aussi sa haine de vie, j'y reviendrai).
Bien sûr on peut être sceptique quand il reproche à Savonarole d'avoir fait augmenter le prix du pain en taxant les riches propriétaires (une façon quand même un peu artificielle de poser le prédicateur en agent de la bourgeoisie à la fois contre la noblesse terrienne et contre le prolétariat), mais plus intéressantes sont ses remarques sur les assemblées populaires au centre des prédications, de ce qui s'y joue de la construction et de la déconstruction de la subjectivité politique du peuple (on peut transposer ça à l'étude contemporaine du rôle de la télévision ou d'Internet, qui ont aussi leur prédicateurs propres). Mëme si la religion ou la morale ne sont jamais réductibles aux rapports de forces sociologiques, il est toujours bon de se démander qui elles servent. L'interrogation sur leur responsabilité politique doit nous hanter. La morale doit ainsi être élargie à la sociologie.

Horkheimer dresse au terme de sa chronologie un portrait qui m'intrigue beaucoup de Robespierre en dernier des prédicateurs bourgeois, usant lui aussi de "grigris magiques" comme les cocardes mais aussi sa vertu personnelle (voir l'opposition avec l'actrice Claire Lacombe p. 216). Robespierre mystique de son Etre suprême, arrivant là au bout d'un processus, et donc à la limite d'un autre quand il doit arbitrer entre plafonnement des prix et blocage des salaires, n'osant pas finalement "le grand saut" dans l'alliance avec le prolétariat (puisqu'il n'ose même pas donner les biens des "suspects" aux sans-culottes pauvres, ce qui eût créé une classe qui dût tout à la Révolution), et qui de ce fait mérite les insultes de la foule parisienne quand on le conduit à l'échafaud.
Le point qui fait le plus question dans la thèse d'Horkheimer, c'est bien sûr son option freudomarxiste. Il y a chez lui une sorte de mysticisme de l'énergie sexuelle, comme il y a une mystique du prolétariat. D'ailleurs il rend hommage à Wilhelm Reich qui fut une caricature dans ce domaine. Pour lui, répression du peuple et répression sexuelle (donc répression de la vie), vont de pair. Et d'une certaine façon la phrase de Saint Just "Le bonheur est une idée neuve en Europe" est pour Horkheimer un des signes de la position-limite des jacobins qui sur la question sexuelle comme sur la question sociale, les place à l'orée d'un autre monde, un monde qui sortirait du culte morbide de l'effort et du devoir propre au monde bourgeois, pour valoriser réellement l'égoïsme pulsionnel tel que le défendent des philosophes sceptiques matérialistes d'Aristippe de Cyrène et Epicure (c'est Horkheimer qui cite lui-même ces exemples, tout en se trompant sur Epicure) à Voltaire et Diderot.
A la différence du vulgarisateur Onfray, je ne suis pas certain qu'on puisse continuer à "bricoler" avec le freudo-marxisme. On ne peut pas simplement donner acte à Horkheimer des critiques qu'il adresse au conservatisme réactionnaire de Freud et estimer que sur cette base on peut continuer à suivre l'Ecole de Francfort. Ce qui est critiquable chez Freud ce n'est pas seulement son conservatisme, mais toute une méthode théorique et pratique. Idem chez Marx. En même temps on ne peut pas complètement jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout en étant encore trop fidèle à Freud, Horkheimer a quand même le mérite de poser la question d'un au-delà de la sexualité bourgeoise et de sa combinaison avec un au-delà de la répression des classes inférieures. Et la question reste d'actualité quand bien même le capitalisme en est venu à intégrer un certain érotisme à son fonctionnement répressif (voyez Luc Boltanski à ce sujet).
Superstitions dans nos campagnes

Actualisation avril 2016 - après mes enquêtes sur les médiums, je ne souscris plus au point de vue exprimé dans cet article qui correspondait à ma période rationaliste étroite. N'oubliez pas cependant que tout acte de sorcellerie, y compris celui de se faire porter, comme la consultation de voyants peut être un pacte avec le monde invisible et avoir des effets secondaires très graves...
Dans une petite ville du Béarn près de Pau, lorsque quelqu'un a le zona, presque tous les généralistes en viennent à lui dire "si vous y croyez vous pouvez aller vous faire porter". Qu'entend-on par là ? Se faire porter c'est aller chez un guérisseur. On m'a parlé d'un d'entre eux. Sexagénaire (né en 1944) deux fois divorcé, un pauvre homme revenu de toute forme de relation avec les femmes. Employé de la ville de Pau, il a dû abandonner son boulot pour cause de dépression. Ses parents vendaient des matelas. Je n'ai pas pu en savoir beaucoup plus sur lui. On m'a expliqué la nature de ses séances (pour lesquelles il reçoit 10 à 15 euros en moyenne, il n'est pas rare que les gens en fassent trois ou quatre).

En arrivant on vous demande si vous y croyez. Le guérisseur a le "pouvoir" de "porter sur lui" le zona des autres parce que lui-même a eu cette maladie. Il prononce alors la formule en béarnais "que portos tu ?" (j'adopte la graphie française en réaction à l'occitanisme) - que portes tu ?. La personne doit répondre "lou cindre" (le zona, en fait même les vieux qui connaissent un peu le béarnais sont peu nombreux à savoir qu'ainsi se nomme la maladie dans cet idiome), puis elle met ses mains sur le dos du guérisseurs qui alors effectue plusieurs fois le tour de la table en prononçant des formules pour lui-même, formules obscures et incompréhensibles. Au fur et à mesure il jette sur la table neuf bâtonnets qu'il a confectionnés. Quelqu'un m'a expliqué que le chiffre neuf a quelque chose de magique "depuis toujours". Jadis on disait que si un malade n'était pas guéri au bout de neuf jours il allait mourir, et l'on faisait dire des messes de neuvaine. A la fin de la séance le guérisseur recommande au malade de réciter trois "je vous salue Marie" le soir ce qui est indispensable à l'efficacité de ce "traitement".
J'ai été surpris de découvrir que ce genre de pratique existait encore et même était encouragé par les médecins professionnels. Compte tenu du nombre de cas de zona, cela doit concerner un nombre de personnes non négligeable.
La persistance de ces pratiques doit être liée au caractère périphérique de cette région (comme celui de la Bretagne ou de l'Auvergne). On a toujours du mal à penser les bizarreries liées aux périphéries. Elles se nichent dans toute sorte de pratique. Quand on me parle du fonctionnement de certaines administrations ou de certaines juridiction en Béarn je reconnais aussi souvent, des signes de son côté "périphérique", mais il demeure toujours clandestin. Cela ne se crie pas sur les toits.
La tombe de Marguerite d'Angoulême à Lescar
Visite à la tombe de Marguerite d'Angoulême "reine de Navarre et écrivain illustre" comme l'indique une plaque des années 1960, à la cathédrales de Lescar.
La reine est toujours aussi absente de l'histoire collective de cette région. Au Château de Pau, mal nommé "Château d'Henri IV", les lettres "H" (pour Henri d'Albret) et "M" (Marguerite d'Angoulême) sont partout présente mais nul ne connaît leur signification sauf les guides qui la mentionnent trop rapidement.
Derrière l'occultation de Marguerite d'Angoulême, il y a, comme je l'ai déjà dit, du machisme, un refus de connaître la Renaissance, un refus de s'intéresser à al littérature, au statut complexe d'une noblesse prise entre catholicisme et idées nouvelles ; pour le Béarn une impossibilité à penser une identité non "kosovoïsée" qui intègre des intéractions avec l'Italie, les Charentes, la Couronne de France. La fixation grossière sur le "Vert galant" au dernier tiers du siècle, évite aux gens de comprendre cette partie bien plus intéressante qui tourne autour des années 1530-1540. Dommage pour cette région et pour la conscience historique de notre époque.
L'excès d'historicisme
J'écoutais ce matin Répliques de Finkielkraut sur Sade (France Culture). J'y entendais un historien énumérer "Il y a eu le Sade figé dans la psychothérapie du XIXe siècle, le Sade vu par les surréalistes comme un libérateur du désir mais cette vision est rapidement devenue caduque, le Sade des années 60, celui d'aujourd'hui."
Je n'aime pas cette vision radicalement historiciste de la réception des oeuvres et de l'évolution des idées. Même si moi-même je ne cesse de constater le passage du temps et d'évaluer notamment combien les idées des années 60 sont dépassées aujourd'hui, je crois que ce serait une erreur de réduire nos mots, nos visions, à des "époques" : telle notion allait bien avec le temps où l'on portait des jeans et le poil long, et où on voyageait avec tel type de voiture, telle autre avec le port de tuniques romaines etc.
Même d'un point de vue positiviste il y a au moins un élément qui s'oppose à cet historicisme radical : la constance depuis 200 000 ans, de certains réflexes, et de certaines aspirations, ancrés dans la nature humaine, et qui en forgent l'arrière-plan existentiel (on n'ose dire métaphysique) par lequel les interprétations stoïciennes, surréalistes, jansénistes etc, de certaines images, de certaines histoires, peuvent être aussi les nôtres. A travers ces constantes, nous pouvons nous approprier les univers et préoccupations des autres époques, et même les refaire vivre, tout en leur trouvant de nouveaux prolongements, et c'est grâce à cela, à cette perpétuelle actualité du passé (que nous pouvons aborder sans anachronisme, sans nier ce qui dans le passé n'est plus nôtre et n'est pas réductible à notre temps) que nous saisissons l'unicité de l'aventure de notre espèce, celle de son avenir, de son présent et de son passé, voire que nous renouvelons et éclairons différemment par le détour par le passé des problématiques contemporaines sclérosées.
Mélenchon, Le Pen, la campagne, les idées
 Un peu inquiet de voir Mélenchon retrouver ses accents agressifs et ses airs de matamore. Traiter un candidat de semi-dément cela ne se fait pas. Menacer unE candidatE de la promener d'un bout à l'autre d'un ring, ce n'est pas élégant, même si ladite candidate a des idées nauséabondes. On trouve à nouveau, à 60 jours de l'élection, le pire de Mélenchon. Je crois qu'il va y laisser des plumes en termes d'intentions de votes.
Un peu inquiet de voir Mélenchon retrouver ses accents agressifs et ses airs de matamore. Traiter un candidat de semi-dément cela ne se fait pas. Menacer unE candidatE de la promener d'un bout à l'autre d'un ring, ce n'est pas élégant, même si ladite candidate a des idées nauséabondes. On trouve à nouveau, à 60 jours de l'élection, le pire de Mélenchon. Je crois qu'il va y laisser des plumes en termes d'intentions de votes.
Un certain David Desgouilles pour Marianne 2 (un e-magazine qui ne m'aime pas et c'est récirpoque : j'ai eu une mauvaise expérience avec son patron à la table de Régis Debray jadis), dit que M. Mélenchon va perdre des voix ouvrières à cause de ces attaques personnelles au dessous de la ceinture, et ne glaner que quelques voix de Middle Class. C'est bien possible. Dommage. Mélenchon a les défauts de ses qualités. Des défauts aussi prononcée que ses qualités le sont. C'est tout le problème. Alors qu'un type comme Hollande, qui ne croit en rien, qui n'est même pas capable de finir avec aisance une phrase, et dissimule mal son absence de conviction derrière des "moi je dis que" et "moi je veux que" n'a que peu de défauts car il a peu de qualités.
Et dire qu'à côté de cela le petit candidat de l'UMP promet une république plébiscitaire populiste cela fait froid dans le dos ! Cette élection est moins désastreuse que celle de 2007 avec les Besancenot-Buffet-Royal, mais tout de même on reste sur sa faim. Pourvu que rien ne permette au candidat sortant de "rebondir" comme on dit. Je le crois capable de tout pour renverser les tables, y compris d'aller tenter des folies en Syrie. C'est très préoccupant.
Bon laissons tomber le théâtre d'ombres, parlons d'idées. Je discutais tantôt avec une écologiste très pointue sur la prévention des risques sanitaires. Ca fait des années que j'essaie de réfléchir à faire converger la pensée géopolitique, et la pensée environnementale. Mais chacun est enfermé dans sa chapelle. Le réseau de l'Atlas alternatif compte pas mal de membres d'EELV. Je ne sais toujours pas comment tracer des ponts utiles là dessus.
En ce moment le seul "pont" entre géopolitique et risques sanitaires qu'inventent nos politiciens est cette question du halal, ce qui n'est pas brillant. Je n'ai toujours pas compris si cette pratique nuit vraiment à la qualité de la viande (on m'a parlé de contenu de la panse qui remonte au niveau du cou quand on coupe la tête de l'animal et contamine cette viande dont on fait du haché pour les enfants ce qui oblige à les cuire davantage avant consommation - est-ce vrai ?), en tout cas il est vrai qu'il est un peu idiot que tous les abattoirs d'Ile de France se soient mis à cette mode, d'autant qu'ils le font sans endormir l'animal alors que les autorités islamiques ne seraient pas hostiles à une telle mesure. J'avais entendu un jour Tariq Ramadan dire qu'il fallait que l'islam réfléchisse à la souffrance animale. Il y a manifestement quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce soudain ralliement (pour des raisons de pure réduction des dépenses) des abattoirs d'Ile de France (mais aussi d'autres régions) à cette méthode d'abattage, et il est dommage que l'on ait attendu que le Front national (avec ses arrières-pensées bien connues) se saisisse de l'affaire pour enfin en débattre sur la place publique. La gauche de la gauche à force de se complaire dans un prêt-à-penser finit par lâcher des sujets très importants (comme aussi celui de la souveraineté des pays du Tiers-Monde par exemple) à ce parti (qui ensuite les traite avec sa propre idiosyncrasie, pas très républicaine comme chacun sait). Mais cette gauche de la gauche peut-elle se ressaisir ? reprendre l'initiative ? retrouver de l'audace intellectuelle et de l'indépendance dans l'approche des sujets importants ? Je l'ai cru quand j'ai vu Mélénchon étudier ses dossiers à fond, et les évoquer avec verve. Je recommence à douter quand je le vois remplacer de plus en plus le courage politique par de simples coups de gueule. C'est inquiétant. Et au vu de l'ampleur des problèmes de notre époque, sur tous les fronts (financiers, écologiques, stratégiques), on est en droit d'exiger mieux.
Alors où, comment ? En sortant définitivement des logiques d'appareil ? Je serais bien placé pour le faire moi qui n'ai jamais été intégré dans aucun. Mais que peut-on faire seul ? Et que peut-on même faire avec ces chimériques "réseaux de blogs" et "réseaux sociaux", nos nouvelles "prime time TVs" ?



